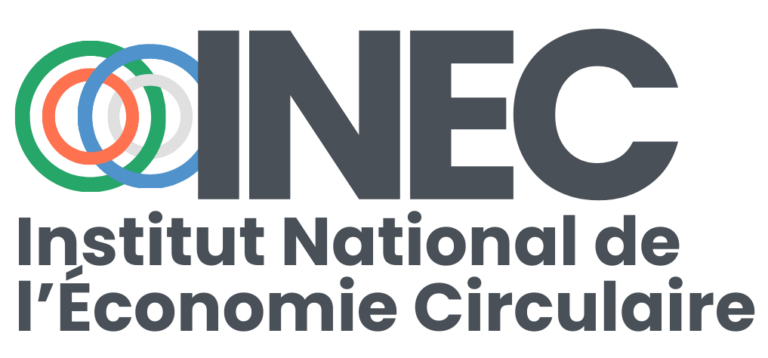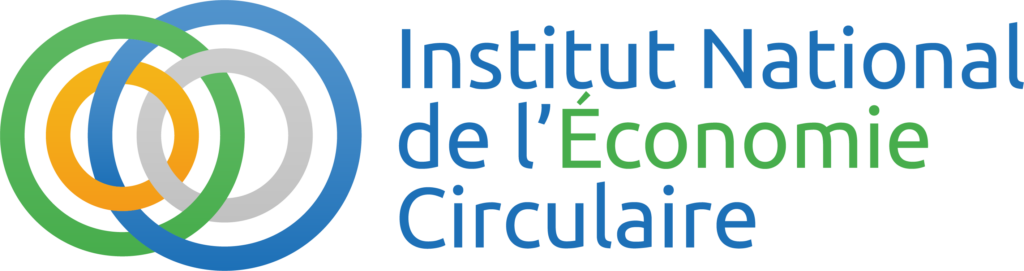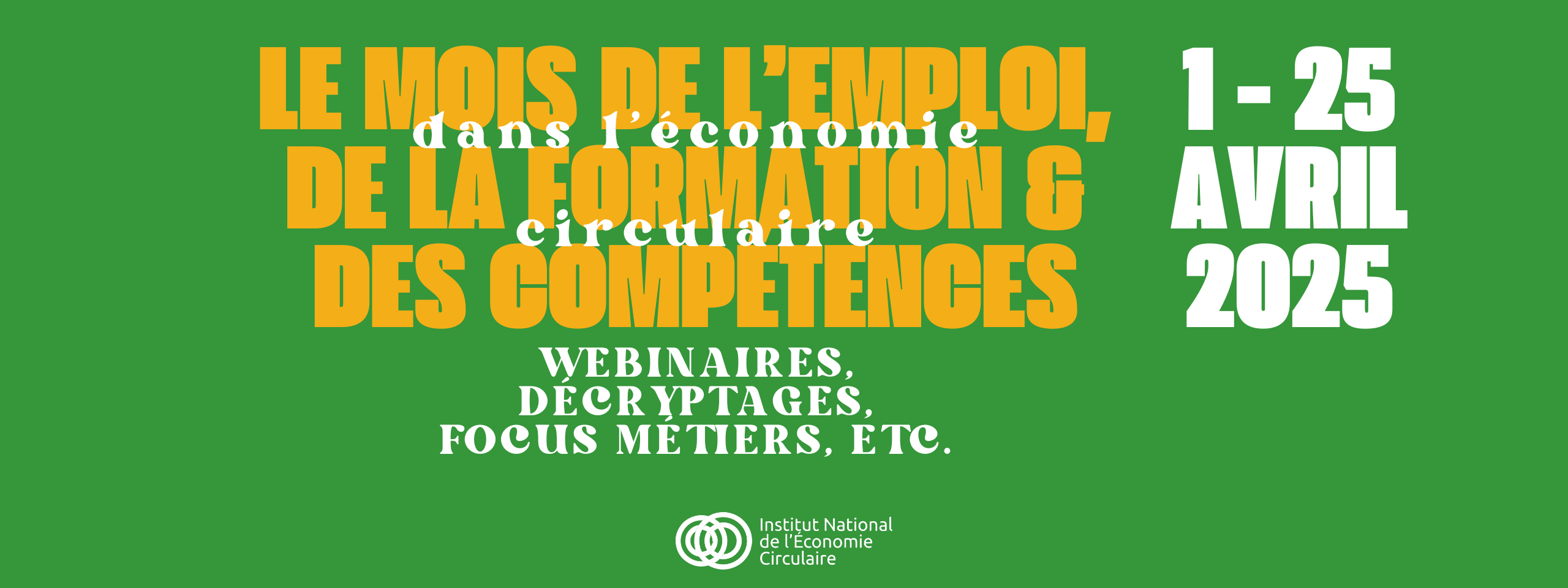VEILLE RÉGLEMENTAIRE
EUROPE
L’Union européenne (UE) adopte une méthode unique pour calculer les émissions de transport et renforcer la transparence environnementale.
Le Parlement européen et le Conseil ont trouvé un accord préliminaire sur une méthodologie unique pour calculer les émissions de gaz à effet de serre des services de transport. Cette méthode permettra de comparer plus facilement les performances environnementales des différents modes de transport et de réduire le risque d’écoblanchiment.
Les entreprises qui choisissent de calculer leurs émissions devront appliquer cette méthodologie, basée sur l’utilisation des véhicules et l’énergie consommée, en privilégiant les données primaires. Un outil de calcul public, simple et gratuit, sera développé pour soutenir les PME.
L’accord prévoit également d’évaluer dans les quatre ans l’intégration des émissions sur l’ensemble du cycle de vie des services de transport, incluant la fabrication, l’entretien, l’utilisation et la fin de vie des véhicules.
La Commission renforce la compétitivité de l’Europe avec de nouveaux plans pour le transport ferroviaire à grande vitesse et des carburants durables pour les secteurs de l’aviation et de la navigation.
La Commission européenne a adopté un ensemble de mesures visant à renforcer la compétitivité et la durabilité du transport en Europe. Le plan pour le rail à grande vitesse prévoit de créer un réseau plus rapide et interopérable d’ici 2040, avec des temps de trajet réduits et de nouvelles liaisons transfrontalières, afin de rendre le rail plus attractif face au transport aérien court-courrier.
Parallèlement, la Commission lance le plan d’investissement pour des transports durables (STIP) afin de stimuler les investissements dans les carburants renouvelables et bas carbone pour l’aviation et la navigation. Environ 20 millions de tonnes de carburants durables seront nécessaires d’ici 2035, ce qui impliquera des investissements estimés à 100 milliards d’euros. La STIP mobilisera au moins 2,9 milliards d’euros d’ici 2027 à travers différents instruments européens.
La Commission investit 2,9 milliards d’euros dans le Fonds pour l’innovation afin de stimuler les projets de technologie “zéro net”.
La Commission européenne a annoncé un financement de 2,9 milliards d’euros pour 61 projets de technologie “zéro net” dans le cadre du Fonds pour l’innovation, utilisant les recettes du système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE).
Ces projets couvrent 19 secteurs industriels et 18 pays, avec un focus sur les industries à forte intensité énergétique, les énergies renouvelables, le stockage d’énergie, les bâtiments “zéro net” et la fabrication de technologies propres. L’objectif est de renforcer le leadership technologique de l’Europe et d’accélérer le déploiement de solutions innovantes pour la décarbonation.
Ces projets ont le potentiel de réduire environ 221 millions de tonnes d’équivalent CO₂ au cours de leur première décennie, contribuant directement à l’objectif de neutralité climatique de l’UE. Après sélection, les promoteurs finaliseront les conventions de subvention avec l’Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement (CINEA).
INSTITUTIONS
L’Autorité de la concurrence publie des orientations informelles pour encadrer la création d’une plateforme de partage de données sur l’empreinte carbone dans la grande distribution.
L’Autorité de la concurrence a publié des orientations informelles concernant la création d’une plateforme de collecte et de partage de données sur l’empreinte carbone des fournisseurs dans le secteur de la grande distribution. Cette initiative, portée par deux organisations professionnelles, a été jugée recevable et analysée dans le cadre du projet LESS (Low Emission Sustainable Sourcing). L’Autorité estime que la plateforme, ouverte, volontaire et non exclusive, ne présente pas de risques majeurs de concurrence dès lors qu’aucun classement des fournisseurs ni échange d’informations sensibles n’est prévu.
Le Rapporteur général a toutefois rappelé plusieurs points de vigilance : faciliter l’accès à la plateforme pour tous les fournisseurs, garantir la qualité des données, et éviter toute coordination entre concurrents, notamment sur les stratégies de décarbonation ou de communication environnementale. Il souligne également que toute publicité des engagements carbone des fournisseurs doit être encadrée afin de respecter le droit de la concurrence.
Le Cerema interroge les acteurs de terrain sur la réutilisation des eaux usées traitées (REUT).
Le Cerema a analysé 25 projets de REUT arrêtés ou relancés, puis sollicité 125 acteurs impliqués (collectivités, bureaux d’études, exploitants) afin de mieux comprendre les obstacles à la mise en œuvre et à la pérennisation de ces dispositifs. Il en ressort que les freins sont multiples : obstacles techniques (liaison entre station d’épuration et site d’usage, qualité de l’eau), modèle économique fragile, gouvernance floue et difficulté de communication entre parties prenantes.
Le rapport souligne que deux leviers sont essentiels pour développer durablement la REUT : une réglementation stabilisée pour les usages et la qualité des eaux traitées, et une meilleure capitalisation des données économiques de projet pour éclairer la faisabilité des futures initiatives. Des facteurs locaux (baisse des précipitations, tensions sur la ressource) sont aussi identifiés comme ayant un impact significatif sur la dynamique des projets.
GOUVERNANCE
Les arrêtés portant nomination au cabinet de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature ont été publiés au Journal Officiel.
Mme Hélène Champollion est nommée conseillère monde économique et intelligence artificielle, et Mme Adèle Foucault est nommée conseillère société civile, précarité sociale et discours.
RÉEMPLOI
Écominéro a présenté son étude sur le réemploi et la réutilisation des matériaux minéraux dans le bâtiment.
Écominéro accompagne les fabricants pour financer la gestion des déchets de matériaux minéraux (béton, brique, tuile, céramique, pierre) et soutient le réemploi dans le bâtiment.
L’étude s’appuie sur 526 réponses à une enquête et 69 entretiens, identifiant les freins principaux : traçabilité et diagnostics incomplets, manque de normes et d’assurance, insuffisance de plateformes logistiques, coûts supplémentaires et préjugés liés au neuf.
Pour chaque obstacle, des leviers sont proposés : fiches techniques standardisées, création d’un métier de requalificateur, hubs logistiques, aides financières ciblées ou encore valorisation des bénéfices du réemploi.
Il est souligné que le réemploi est perçu positivement par les acteurs opérationnels et les structures ESS, tandis que collectivités et opérateurs publics restent prudents. Des initiatives locales montrent la faisabilité des actions permettant de renforcer la circularité dans la filière minérale du bâtiment.
FINANCEMENT
Une table ronde s’est tenue à l’Assemblée nationale sur le financement de l’économie circulaire.
Une table ronde organisée par la Commission du developpement durable et de l’aménagement du territoire sur le financement de l’économie circulaire a réuni des représentants du Conseil national de l’économie circulaire (CNEC), de la DGPR et du collectif des éco-organismes.
Les discussions ont porté sur la mise en œuvre concrète de l’économie circulaire, les investissements et éco-contributions en forte hausse, et les résultats encore inégaux selon les filières. Si la loi AGEC a accéléré la structuration des filières de recyclage et permis de réduire les déchets mis en décharge, certaines filières restent fragiles, notamment le plastique, le bâtiment et le textile.
Les intervenants ont souligné la nécessité de renforcer la stratégie nationale de l’économie circulaire, de mieux flécher les financements, et de soutenir l’éco-conception, le réemploi et la réparation. Ils ont aussi insisté sur l’importance de créer un véritable marché de matières recyclées, de protéger l’industrie européenne et d’adopter une vision systémique de la chaîne de valeur.
Le CNEC et les éco-organismes se sont positionnés pour proposer des plans d’investissement clairs et des mesures de gouvernance renforcées, afin d’optimiser l’utilisation des fonds et sécuriser le financement des filières.
DÉCHETS
Le ministère de la Transition écologique publie les données 2023 sur les déchets alimentaires en France et dans l’Union européenne.
En 2023, la France a produit 9,7 millions de tonnes de déchets alimentaires, soit 142 kg par habitant, un niveau supérieur à la moyenne européenne (130 kg/hab.). Parmi ces déchets, près de 40 % étaient encore consommables, représentant 3,8 millions de tonnes de gaspillage alimentaire. Les ménages constituent la principale source de ces déchets, avec 43 % du total, suivis par la transformation, la production primaire, la consommation hors domicile et la distribution.
Au niveau européen, les volumes varient fortement : l’Espagne (65 kg/hab.) et la Slovénie (78 kg/hab.) produisent le moins de déchets alimentaires par habitant. Chypre (286 kg/hab.) et le Danemark (261 kg/hab.) affichent les niveaux les plus élevés. Les proportions de déchets selon les étapes de la chaîne alimentaire diffèrent selon les pays, reflétant leurs pratiques agricoles, industrielles et alimentaires.
En France, la production primaire génère 1,3 million de tonnes de déchets (0,9 % des récoltes), principalement des pommes de terre et légumes. La consommation à domicile reste la source majeure de gaspillage, avec 1,3 million de tonnes de produits encore comestibles jetés, dont une partie est déjà emballée. Enfin, seulement 13 % des déchets alimentaires ménagers sont compostés à domicile ou collectivement.
Une consultation publique est en cours, relative à un projet d’arrêté fixant des critères de sortie du statut de déchet.
Le ministère de l’Environnement lance une consultation sur trois projets d’arrêtés visant à encadrer la sortie du statut de déchet (SSD) pour certaines catégories de déchets. Les projets concernent : les particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage ou de leur fabrication, l’huile de thermolyse provenant de la valorisation des pneus et les terres excavées ou sédiments préparés pour des usages en génie civil ou en aménagement.
La SSD, prévue par la directive cadre 2008/98/CE, permet à un déchet de devenir un produit réutilisable si quatre conditions sont respectées : usage spécifique, existence d’un marché, conformité aux exigences techniques et absence d’effets nocifs pour l’environnement ou la santé. Les arrêtés précisent donc les critères techniques et réglementaires pour que ces déchets puissent être valorisés sans rester sous statut de déchet.
L’objectif est de favoriser l’économie circulaire et la valorisation des déchets, notamment pour les pneus et les terres excavées, en ouvrant la possibilité d’une utilisation agricole pour ces dernières.