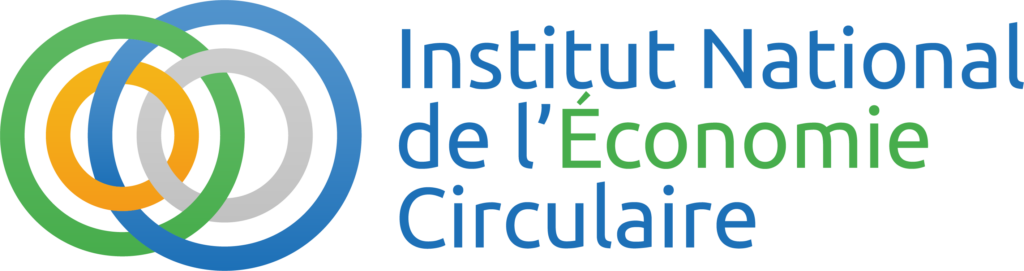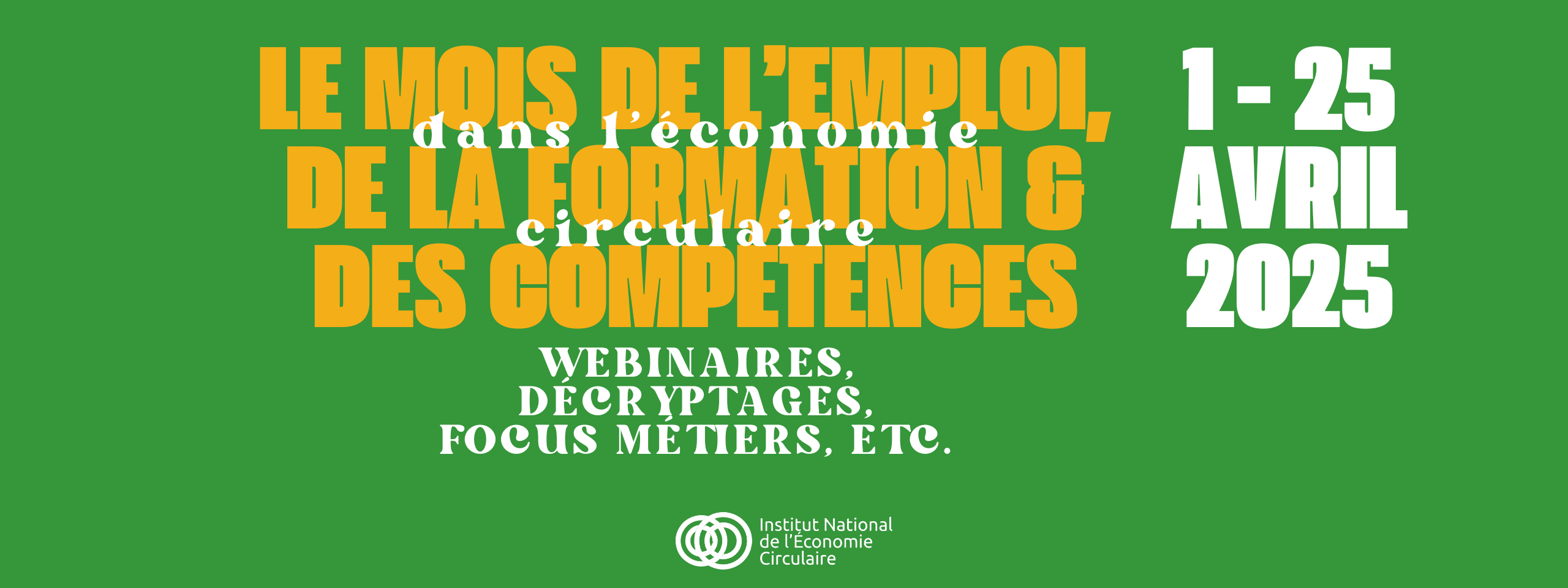VEILLE RÉGLEMENTAIRE
EUROPE
La Commission européenne publie un rapport sur une “résilience 2.0” pour anticiper les crises et guider ses politiques futures.
Dans son rapport de prospective stratégique 2025, la Commission européenne introduit le concept de « résilience 2.0 », une approche plus anticipative et proactive pour faire face aux chocs à venir. Face à l’accélération des transitions climatiques, à la montée des menaces sécuritaires et à une concurrence géopolitique accrue, l’UE cherche à renforcer sa capacité à protéger ses citoyens, garantir sa souveraineté et adapter ses politiques publiques.
Ce nouveau cadre appelle à intégrer la prospective de manière systématique dans l’élaboration des politiques. Dès 2026, les rapports annuels de prospective ne se limiteront plus à l’analyse des tendances, mais évalueront aussi l’impact de différents scénarios d’avenir sur l’Europe.
Le rapport identifie huit grands axes d’action pour renforcer la résilience européenne, couvrant des enjeux tels que la sécurité, la transformation technologique, la compétitivité économique, l’inclusion sociale, la démocratie ou encore les défis démographiques.
Le Parlement européen publie la directive à venir sur le suivi et la résilience des sols.
Dans le cadre du Pacte vert, l’Union européenne progresse vers une directive visant à assurer des sols en bonne santé d’ici 2050. Le texte introduit une définition commune du sol sain, des obligations de suivi, et des mesures contre les sites contaminés.
Un accord provisoire avait été trouvé en avril 2025 entre le Parlement, le Conseil et la Commission. Il accorde plus de flexibilité aux États membres et recentre le texte sur le soutien à la gestion durable.
Le vote final du Parlement est attendu en octobre 2025. La directive pourrait devenir un pilier important de la stratégie environnementale européenne.
INSTITUTIONS
L’IGEDD juge que les efforts de la France sont insuffisants en matière de fin de vie des déchets textiles.
Dans un rapport publié le 5 septembre 2025, l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) dresse un constat préoccupant sur les exportations de textiles usagés et de déchets d’habillement hors de l’Union européenne, en particulier vers l’Afrique.
Le rapport souligne que 90 % des textiles collectés en seconde main et non réutilisés en Europe sont exportés, avec une part significative (jusqu’à 40 % selon les cas) se transformant en déchets non traités sur place.
Le manque de coordination réglementaire entre États membres, l’ambiguïté juridique autour des définitions de « déchets » et de « textiles usagés », et l’absence de traçabilité favorisent les fraudes et empêchent un contrôle efficace.
Face à ce constat, l’IGEDD recommande une approche globale en utilisant les outils contractuels, la réglementation renforcée et une transformation structurelle de la filière. Elle propose d’imposer des contrats encadrant les exportations, conditionnant notamment l’aide de l’éco-organisme Refashion, et de mieux encadrer la sortie du statut de déchet (SSD) au niveau européen en évaluant la capacité des pays destinataires à traiter les flux reçus.
Enfin, le rapport appelle à une montée en puissance industrielle de la filière en France et en Europe, avec un soutien renforcé de Refashion. Il insiste sur l’urgence d’adapter les capacités de tri, de traitement et de traçabilité pour réduire la dépendance aux exportations, dans un contexte où seuls 32 % des textiles usagés sont aujourd’hui collectés, alors que ce taux devra doubler d’ici 2028.
Premier débat public global : bilan de la concertation sur l’avenir industriel du bassin de Fos-Berre-Provence.
La Commission nationale du débat public (CNDP) a publié les conclusions du débat public global organisé du 2 avril au 13 juillet 2025 sur l’avenir industriel du bassin Fos-Berre-Provence.
Il s’agit de la première application de la loi Industrie verte du 23 octobre 2023 permettant une concertation élargie sur un ensemble de projets, et non sur un projet unique.
Cette démarche inédite a permis d’associer les acteurs du territoire et le public à une réflexion collective sur plusieurs dizaines de projets industriels liés à la transition écologique et à la réindustrialisation. Le bilan met en avant une forte attente de transparence, de cohérence territoriale, et de garanties environnementales dans les choix à venir.
La Cour des comptes publie son premier rapport sur la transition écologique.
Dans un contexte d’urgence climatique, la Cour des comptes publie son premier rapport annuel dédié à la transition écologique. Elle dresse un état des lieux des politiques publiques engagées en France et interroge leur efficacité et leur cohérence.
La Cour constate que les collectivités et les administrations se mobilisent, soutenues par une structure interministérielle dédiée (SGPE), mais que cette gouvernance doit être renforcée. Elle appelle notamment à une meilleure coordination de l’action publique, à travers une stratégie plus claire et partagée, et un renforcement de la planification écologique.
Le rapport insiste sur la nécessité de mieux évaluer les besoins financiers et de préciser l’usage des outils publics. Il recommande de fixer des objectifs sectoriels clairs dans la Stratégie nationale bas carbone (SNBC), de présenter une stratégie pluriannuelle de financement en amont des lois de finances, et d’identifier les leviers les plus efficaces.
Le rapport recommande une action urgente fondée sur la mise en œuvre durable des six priorités environnementales européennes, notamment à travers la transition vers une économie circulaire et la préservation de la ressource.
Enfin, le rapport souligne l’importance de prendre en compte la capacité contributive des ménages dans les politiques de transition, afin de garantir une répartition équitable des efforts.
AMÉNAGEMENT
Transformer les bureaux vacants en logements : un levier pour la transition écologique et la crise du logement.
La réhabilitation d’anciens bureaux en logements est désormais considérée comme un levier structurant pour répondre à la crise du logement et limiter l’artificialisation des sols. Avec plus de 9 millions de m² de bureaux vacants en France, cette approche constitue une opportunité majeure de réemploi du bâti au service de la transition écologique et de la sobriété foncière.
Deux rapports viennent appuyer cette dynamique. Le premier propose de simplifier la réglementation pour lever les freins techniques. Le second avance un modèle économique incitatif, incluant la création de Foncières de Transformation de Bureaux (FTB). L’objectif étant de structurer une véritable filière du reconditionnement.
Le fait de transformer des bâtiments déjà existants s’inscrit dans une logique d’économie circulaire, cette stratégie permettant de réduire l’empreinte carbone de ce secteur.
EMBALLAGES
Proposition de loi pour généraliser le réemploi des emballages en France.
Le 16 septembre, un groupe de 89 députés a déposé à l’Assemblée nationale une proposition de loi visant à généraliser le réemploi des emballages sur le territoire français.
Cette proposition intervient dans un contexte d’échec partiel des objectifs actuels, notamment le taux de réemploi plafonnant à 1,1 % en 2023, très loin des 5 % visés. Ainsi, elle vise à accélérer la généralisation du réemploi des emballages dans le cadre de la loi AGEC et de la transition vers une économie circulaire. Elle fixe des objectifs ambitieux : 20 % d’emballages réemployés d’ici 2030, puis 50 % d’ici 2040, avec des quotas contraignants pour les metteurs en marché. Des standards obligatoires et des déclarations annuelles à l’ADEME sont prévus afin de renforcer le pilotage et la transparence.
Le texte prévoit également la reprise obligatoire des emballages réemployables en grande distribution dès 2028, ainsi que le doublement du budget des éco-organismes dédié au réemploi. Il impose l’usage exclusif d’emballages réemployables dans les manifestations accueillant du public à partir de 2027.
Ce cadre législatif entend créer une véritable filière industrielle du réemploi, génératrice d’emplois locaux, de réduction des déchets plastiques, et d’économies pour les entreprises et les collectivités. Il s’inscrit dans la continuité du règlement européen sur les emballages, adopté en 2025, qui encourage les États membres à développer le réemploi.