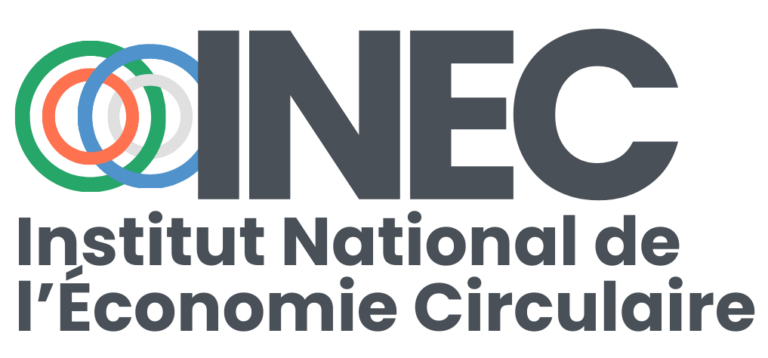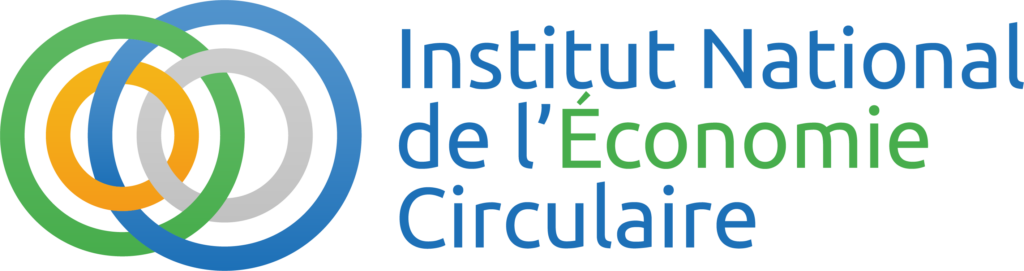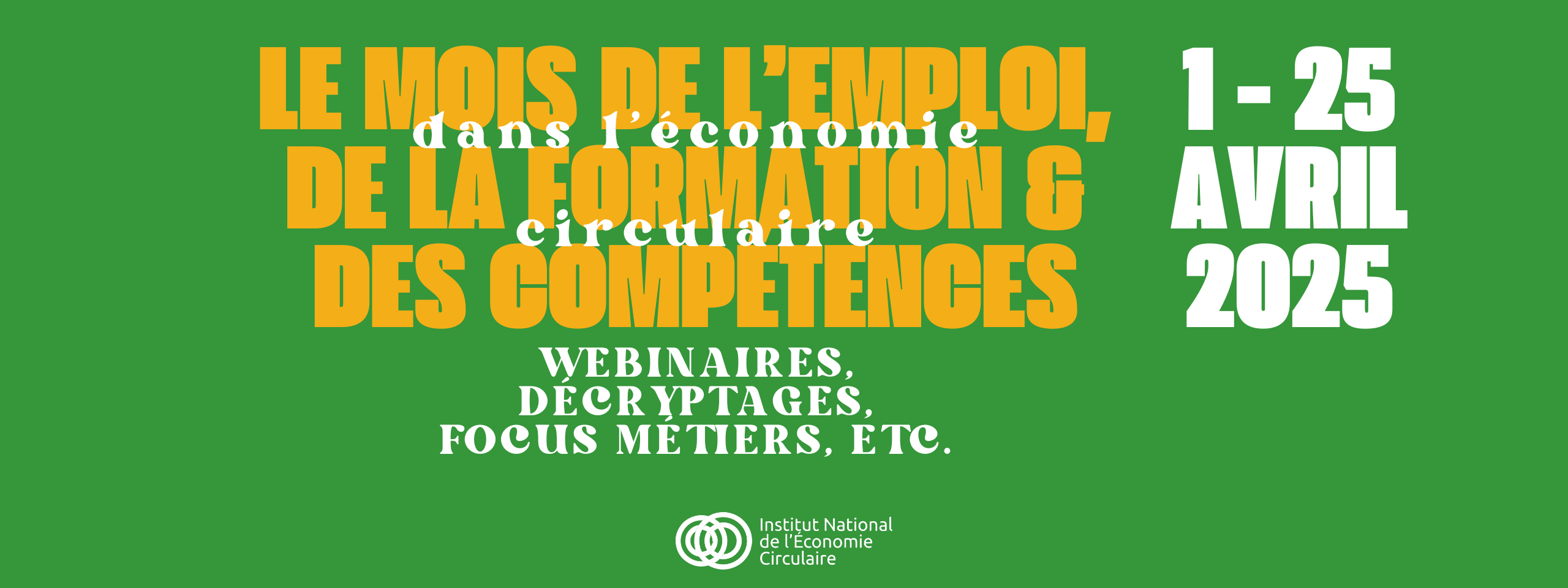VEILLE RÉGLEMENTAIRE
EUROPE
Les émissions mondiales de CO₂ fossile repartent à la hausse en 2025 malgré un rebond des puits de carbone terrestres.
Le Global Carbon Budget 2025 montre que les émissions mondiales de CO₂ fossile devraient encore augmenter de 1,1 % en 2025, malgré un ralentissement en Chine et en Inde. Les États-Unis et l’Union européenne connaîtraient aussi une légère hausse liée aux conditions météo et à la demande énergétique. En revanche, les émissions liées aux changements d’usage des terres devraient diminuer grâce à la baisse de la déforestation et des feux en Amérique du Sud.
Le rapport souligne que le budget carbone restant pour limiter le réchauffement à 1,5 °C est quasiment épuisé : au rythme actuel, il serait consommé en quatre ans. Les puits naturels de carbone restent essentiels mais leur efficacité diminue à cause du changement climatique. Certaines forêts tropicales d’Amazonie et d’Asie du Sud-Est émettent désormais davantage de CO₂ qu’elles n’en absorbent.
La concentration de CO₂ dans l’atmosphère devrait atteindre 425,7 ppm en 2025. Malgré une stabilisation relative par rapport au pic de 2024, la tendance reste très préoccupante : la croissance de la demande énergétique dépasse encore les progrès de la décarbonation.
Le Parlement européen fixe un objectif de réduction de 90% des émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici 2040.
La commission de l’environnement du Parlement européen soutient désormais un objectif climatique de -90 % d’émissions en 2040 (par rapport à 1990), afin de maintenir la trajectoire vers la neutralité climatique de l’UE en 2050. Cet objectif deviendrait juridiquement contraignant.
Pour donner plus de flexibilité aux États membres, les députés acceptent l’usage à partir de 2036 de jusqu’à 5 % de crédits carbone internationaux de haute qualité. Ils approuvent également la possibilité d’utiliser davantage d’absorptions de carbone domestiques et valident le report du SEQE2 à 2028.
L’Union européenne (UE) soutient la transition propre en investissant plus de 358 millions d’euros dans 132 projets dans toute l’Europe.
La Commission européenne a annoncé un investissement de plus de 358 millions d’euros pour soutenir 132 nouveaux projets dans le cadre du programme LIFE, couvrant l’environnement, l’action climatique et la transition vers une économie propre. Ces fonds représentent plus de la moitié du budget total mobilisé, le reste provient d’autorités publiques, d’entreprises et d’organisations de la société civile.
Les projets sélectionnés couvrent l’ensemble des priorités européennes : biodiversité, restauration des habitats naturels, économie circulaire, amélioration de la qualité de vie, adaptation au changement climatique et déploiement des énergies propres.
Avec ces nouveaux projets, le programme LIFE continue de jouer un rôle important dans la stratégie climatique de l’UE. Actif depuis 33 ans, il a déjà cofinancé plus de 6 500 projets et s’inscrit dans l’objectif européen d’une économie neutre en carbone d’ici 2050.
Le Parlement européen a approuvé la réduction des obligations d’information et des exigences en matière de durabilité pour les entreprises.
Le Parlement européen a adopté sa position visant à simplifier les obligations de reporting en matière de durabilité et de devoir de vigilance. Les rapports environnementaux et sociaux ne seraient désormais exigés que des très grandes entreprises, celles comptant plus de 1 750 salariés et réalisant plus de 450 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Concernant le devoir de vigilance, les obligations ne s’appliqueraient qu’aux entreprises de plus de 5 000 employés et 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires. Ces sociétés devraient utiliser une approche fondée sur le risque et ne demander des informations supplémentaires à leurs petits partenaires qu’en dernier recours. Elles ne seraient plus tenues d’élaborer de plan de transition climatique, et la responsabilité en cas de manquement relèverait des législations nationales.
Les députés demandent également la création d’un portail numérique unique pour faciliter l’accès des entreprises aux modèles, aux lignes directrices et aux obligations européennes.
INSTITUTIONS
L’Agence internationale de l’énergie (AIE) appelle à renforcer les régulations et les investissements pour sécuriser la transition énergétique mondiale.
Le World Energy Outlook 2025 souligne que la sécurité énergétique mondiale devient de plus en plus complexe, avec des risques liés à un large éventail de combustibles et de technologies. La diversification des approvisionnements et la coopération internationale sont désormais majeures pour faire face aux tensions géopolitiques et aux incertitudes économiques.
La demande mondiale d’énergie continue d’augmenter, portée par la mobilité, l’usage domestique et industriel, ainsi que par les besoins des centres de données et de l’IA. L’électricité devient centrale, avec une consommation croissante plus rapide que celle de l’énergie globale. Les investissements dans l’électricité, les énergies renouvelables (surtout solaire) et le nucléaire augmentent, mais les réseaux et le stockage sont en difficulté.
Enfin, le rapport rappelle les défis persistants : 730 millions de personnes sans électricité, près de 2 milliards dépendant de modes de cuisson polluants, et le risque climatique dépassant 1,5°C même avec des réductions rapides des émissions.
L’ADEME publie l’étude IT4Green sur les impacts environnementaux réels des solutions numériques.
L’ADEME a publié les résultats de la deuxième phase de l’étude IT4Green, qui évalue les impacts environnementaux nets des solutions numériques en France. L’objectif est de déterminer dans quelle mesure le numérique peut contribuer positivement à la transition écologique, en tenant compte des effets directs et indirects sur le climat, les ressources et l’énergie.
L’étude analyse cinq cas d’usage dans les secteurs de la mobilité, de l’énergie, de l’urbanisme, de l’agriculture et du télétravail. Les résultats montrent que le numérique peut générer des gains environnementaux, mais ceux-ci restent modestes et fragiles, fortement dépendants du contexte et des pratiques mises en œuvre.
Les principaux risques identifiés sont l’effet rebond (les économies réalisées pouvant conduire à plus de consommation) et la dépendance accrue aux ressources en métaux et minéraux.
L’ADEME conclut que le numérique peut être un allié de la transition écologique, à condition d’être utilisé avec sobriété, intégré dans une stratégie globale de décarbonation et accompagné d’une vigilance sur ses impacts indirects. Les technologies récentes, comme l’IA générative, n’ont pas encore été évaluées faute de données suffisantes.
DÉCARBONATION
Un nouveau décret fixe les modalités d’attribution des quotas carbone aux autorités de mobilité.
Le décret du 7 novembre 2025 définit les modalités d’attribution d’une fraction des quotas issus de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre aux autorités organisatrices de la mobilité en France.
Le texte précise quelles entités sont considérées comme affectataires : les autorités organisatrices de la mobilité (régions, métropoles, communes continuant à gérer un service de transport public) et l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais. La répartition des quotas se fait proportionnellement à la population et modulée selon le revenu par habitant, afin d’adapter les financements aux besoins et capacités locales.
Le décret prévoit également des exceptions, notamment pour Lyon, où l’autorité organisatrice régionale reçoit directement la fraction de quotas sur son territoire mais peut reverser une partie aux intercommunalités concernées.
ENVIRONNEMENT
Un projet de loi prévoit d’adapter le droit français à 75 textes européens dans les domaines économiques, énergétiques et environnementaux.
Le projet de loi vise à transposer plusieurs législations européennes dans le domaine de l’énergie et du climat. Il reprend les dispositions relatives aux énergies renouvelables, avec la possibilité de créer des zones d’accélération renforcée pour les projets et un renforcement de la transparence et de l’accès aux données électriques.
Le texte prévoit aussi des mesures pour la décarbonation des transports et la durabilité énergétique, en facilitant les projets de stockage géologique de CO2. Il fixe un régime de sanctions pour la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie et assure la transposition de la directive sur la performance énergétique des bâtiments.
Dans le secteur industriel et environnemental, il complète les règles sur la prévention du bruit, la gestion des déchets et emballages, et fixe des exigences d’écoconception et de réduction des émissions industrielles.
INDUSTRIE
L’industrie verte est un moteur des nouvelles ouvertures de sites industriels en 2025.
Le Baromètre industriel de l’État, publié par la DGE, suit la création et l’extension des sites industriels en France. Au premier semestre 2025, le rythme de réindustrialisation ralentit fortement, avec un solde net d’ouvertures de +9 seulement, contre +48 le semestre précédent, ce qui reflète la baisse des investissements étrangers et une concurrence internationale accrue.
Malgré ce ralentissement, certains secteurs restent dynamiques. L’industrie verte, portée par l’économie circulaire, continue de se développer grâce à l’ouverture de sites dédiés au recyclage et au reconditionnement de matériels.
GOUVERNANCE
Deux conseillères sont nommées au cabinet du ministre délégué chargé de la transition écologique.
Aude LEDAY-JACQUET est nommée conseillère « Territoires, Sobriété foncière, Qualité de l’air, Nuisances sonores », et Shaheen JAVID est nommée conseillère « Entreprises, Attractivité et Economie circulaire » au cabinet du ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique.
Les Amis de la Terre publient un classement des grandes villes françaises selon leur consommation de gaz fossile.
Les Amis de la Terre France mettent en lumière la dépendance des communes françaises au gaz fossile à l’approche de la COP30. La plateforme sortonsdugaz.fr permet aux citoyens de mesurer la consommation par habitant et l’argent versé à des pays producteurs.
Le gaz représente encore 18 % de la consommation énergétique nationale et est promu comme énergie de transition, malgré son impact climatique élevé, sa contribution à la pollution et à la dépendance énergétique vis-à-vis de régimes autoritaires.
Le classement 2023 des villes de plus de 100 000 habitants montre de fortes disparités : Amiens, Reims, Strasbourg et Le Havre sont les plus dépendantes, tandis que Grenoble, Perpignan, Toulon, Montpellier et Nice consomment le moins. Les communes peuvent agir via la rénovation énergétique et le remplacement des chauffages fossiles, avec des exemples de succès à Paris et Malaunay.