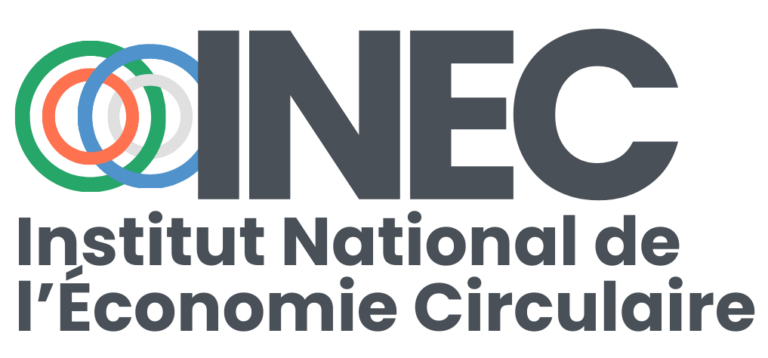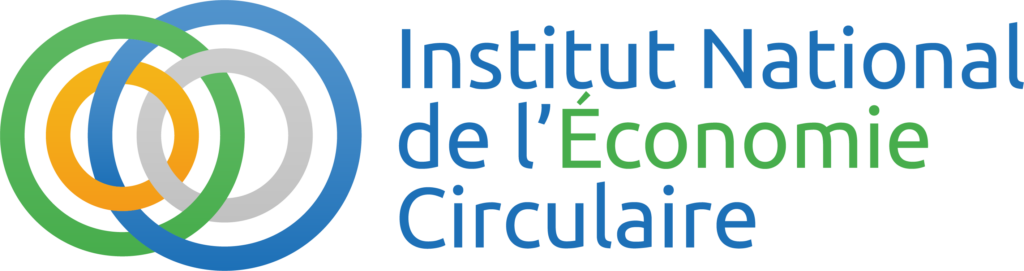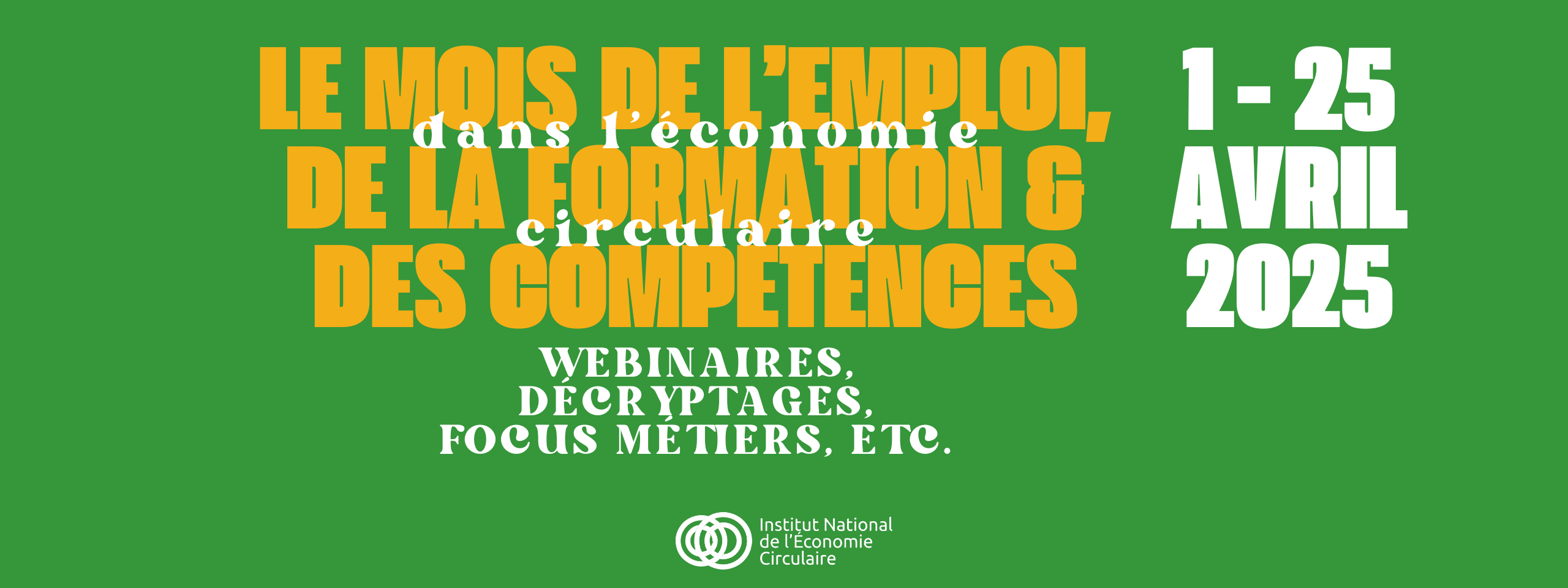VEILLE RÉGLEMENTAIRE
EUROPE
La Cour des comptes européenne publie un rapport d’audit sur la gestion des déchets municipaux.
La Cour des comptes européenne pointe les difficultés des États membres à gérer efficacement leurs déchets municipaux, malgré les exigences de l’UE pour favoriser l’économie circulaire. La collecte séparée reste faible, les infrastructures de recyclage insuffisantes et les redevances ne couvrent pas les coûts, freinant la prévention, le réemploi et le recyclage.
Les auditeurs recommandent de créer un cadre économique favorable aux recycleurs, de lever les obstacles au marché des matières secondaires et d’harmoniser les taxes sur la mise en décharge et l’incinération. Les retards et dépassements de coûts dans les projets cofinancés par l’UE montrent que des instruments économiques plus efficaces sont nécessaires pour atteindre les objectifs européens de circularité.
Un règlement délégué précise la méthode d’évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants bas carbone.
La Commission européenne a adopté un règlement délégué établissant une méthode pour calculer les réductions d’émissions de gaz à effet de serre liées aux carburants bas carbone, à l’exception des carburants à base de carbone recyclé.
Cette méthode prend en compte l’ensemble du cycle de vie, les émissions indirectes, les fuites de méthane et le captage et stockage du carbone, afin de garantir une évaluation précise et cohérente avec les carburants renouvelables.
Le règlement prévoit également de suivre l’évolution des technologies, comme l’hydrogène bas carbone et d’adapter les calculs dès que les données scientifiques le permettront. L’objectif est d’assurer une cohérence entre les différentes filières de carburants à faible intensité carbone et de soutenir la transition énergétique en Europe.
Le règlement d’exécution relatif au format de communication des données, aux méthodes d’évaluation et aux conditions opérationnelles concernant la collecte et le traitement des déchets de batteries a été publié.
La commission européenne a publié le règlement d’exécution (UE) 2025/2289 pour préciser la manière dont les États membres doivent collecter et transmettre leurs données sur les déchets de batteries. Il fixe les formats de communication, les méthodes d’évaluation et les exigences pour les rapports de contrôle qualité, afin de garantir la fiabilité et la comparabilité des informations.
Ces données permettront de suivre la réalisation des objectifs de collecte, de recyclage et de valorisation des matières, d’évaluer l’impact des évolutions du marché et des nouvelles technologies, et de réviser si nécessaire les niveaux de performance en matière de recyclage et de valorisation des batteries.
Le règlement impose également une communication électronique standardisée pour l’ensemble des informations, différenciées selon les types de batteries et leurs caractéristiques chimiques.
INSTITUTIONS
La Direction des Achats de l’Etat (DAE) publie une fiche pratique pour l’application de l’article 58 de la loi AGEC.
La fiche‑outil précise comment les acheteurs publics doivent appliquer les obligations de l’article 58 de la loi AGEC : acquérir chaque année une part minimale de biens issus du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées.
Elle liste 17 catégories de produits concernées, notamment : mobilier, matériel informatique, fournitures de bureau, véhicules, électroménager, et indique les pourcentages minimaux de dépenses à consacrer à des biens réemployés ou recyclés pour 2024, 2027 et 2030.
La fiche propose des exemples de clauses et critères à insérer dans les marchés publics pour respecter ces obligations, ainsi que des pistes de mise en œuvre : marchés dédiés, lots réservés à l’économie sociale et solidaire, utilisation de dons comptabilisés, ou plan de progrès si l’offre ne suffit pas.
L’ADEME publie un avis “Vers une économie de la sobriété”.
L’ADEME souligne que la sobriété est essentielle pour atteindre la neutralité carbone, préserver les ressources et renforcer la résilience économique. Elle repose sur trois piliers : réinterroger les besoins, adapter modes de vie et production, et réduire la demande en ressources et émissions.
La sobriété, complémentaire à l’efficacité énergétique, peut produire des résultats rapides et durables en ancrant les changements dans les comportements, tout en évitant l’effet rebond. Elle contribue également à la souveraineté économique en réduisant la dépendance aux importations et en stimulant l’économie locale.
Un rapport de l’ADEME présente les performances actuelles des centres de tri de déchets d’activités économiques (DAE) et les perspectives d’évolution du secteur.
Un rapport de l’ADEME dresse un état des lieux des centres de tri des déchets d’activités économiques en France et propose des perspectives d’évolution du secteur. Les DAE, dont la production totale atteignait 64 millions de tonnes en 2021, sont encadrés par la loi TECV et la loi AGEC, qui fixent des objectifs de tri, de réduction et de valorisation, notamment à travers l’extension des filières REP.
L’étude a analysé les équipements de tri disponibles, audité plusieurs installations et défini une méthodologie pour évaluer leur performance. Elle met en lumière la diversité et l’agilité des centres de tri, ainsi que les spécificités liées à la variabilité des gisements entrants.
Enfin, le rapport identifie les besoins actuels et futurs en matières recyclées et anticipe les évolutions à venir, réglementaires ou technologiques, afin de mieux accompagner les acteurs du secteur et renforcer l’efficacité de la filière de tri.
L’ADEME publie une étude sur les démarches de réduction des impacts en entreprise.
Une étude de l’ADEME analyse la maturité des entreprises françaises en matière de réduction des impacts environnementaux, avec un focus sur l’écoconception. Basée sur les réponses de plus de 1 100 entreprises, elle montre que ces démarches améliorent l’image des entreprises et suscitent une forte volonté de poursuite : 88 % des structures engagées souhaitent aller plus loin.
L’étude évalue la capacité des entreprises à piloter stratégiquement leurs projets, mettre en œuvre des actions opérationnelles et connaître l’impact environnemental de leurs produits et services. Elle met en évidence que les entreprises ayant bénéficié d’accompagnement ADEME affichent un niveau de maturité supérieur.
Elle identifie les principaux besoins pour progresser : accompagnement, formation et outils adaptés, avec des priorités qui varient selon la taille des entreprises.
L’ADEME publie le volet B de son analyse sur la consigne et le réemploi des emballages.
L’analyse étend l’évaluation environnementale à huit nouveaux scénarios comparant emballages consignés en verre ou plastique à leurs alternatives à usage unique. L’étude, fondée sur l’analyse du cycle de vie, vise à identifier les conditions où le réemploi présente un avantage environnemental pour le secteur agroalimentaire.
Les résultats montrent que les emballages réemployables sont généralement plus avantageux pour des masses d’emballages faibles ou après un certain nombre d’utilisations, avec des bénéfices accentués pour des distances de distribution courtes et des emballages à usage unique plus lourds.
Certaines exceptions apparaissent, notamment pour les bouteilles légères en PET qui peuvent être plus performantes que le verre réemployable.
L’étude met aussi en avant des leviers d’écoconception pour réduire l’impact des emballages, à usage unique ou réemployables, en optimisant le poids, les dimensions, le transport, les taux de réemploi et l’utilisation de matières recyclées.
DÉCARBONATION
L’Office français de la biodiversité (OFB) a publié une étude sur les aires protégées mobilisées pour la séquestration du carbone.
L’OFB a présenté le rôle des aires protégées dans la séquestration du carbone par les milieux naturels. L’étude montre des stratégies comme la préservation des tourbières, des mangroves et des vieilles forêts, ainsi que la restauration écologique pour renforcer l’absorption de carbone.
Des partenariats public-privé innovants sont également soulignés, notamment pour le développement de labels bas-carbone et la valorisation du carbone bleu sur les littoraux. Ces démarches sont illustrées par des exemples dans le Parc national des Calanques ou le massif du Jura.
L’objectif est de concilier la lutte contre le changement climatique et la conservation de la biodiversité, en adaptant les méthodes à chaque écosystème et en mobilisant les gestionnaires d’aires protégées comme acteurs de la transition écologique.
RECYCLAGE
La convention internationale de Hong Kong sur le recyclage sûr et écologique des navires est publiée par décret.
Le décret du 17 novembre 2025 encadre la nouvelle filière REP pour les emballages destinés aux ménages et aux professionnels. Il impose aux producteurs de financer ou d’organiser la collecte, le réemploi, le recyclage et la valorisation des déchets issus de leurs emballages, incluant certains contenants comme ceux d’huiles ou de produits chimiques.
Le texte précise les rôles des éco-organismes agréés, les critères de traçabilité, les soutiens financiers aux professionnels et les définitions des types d’emballages concernés.
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
La députée Anne-Cécile Violland a présenté une proposition de résolution visant à faire de l’approche « Une Seule Santé » grande cause nationale 2026.
Une proposition de résolution vise à faire de l’approche « Une Seule Santé » la grande cause nationale 2026. Cette démarche repose sur l’interdépendance entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes, essentielle pour prévenir les crises sanitaires, lutter contre l’antibiorésistance et protéger la biodiversité.
La proposition s’appuie sur les engagements internationaux de la France et ses plans nationaux santé-environnement. Elle souligne l’importance d’une approche intégrée et transversale impliquant les administrations, les collectivités, les associations et les acteurs privés.
Cette résolution encouragerait la mise en place d’une stratégie interministérielle, le renforcement du soutien aux acteurs de terrain, le développement de la recherche et de la collecte de données, ainsi que la promotion d’une gouvernance internationale fondée sur le principe « Une Seule Santé ».