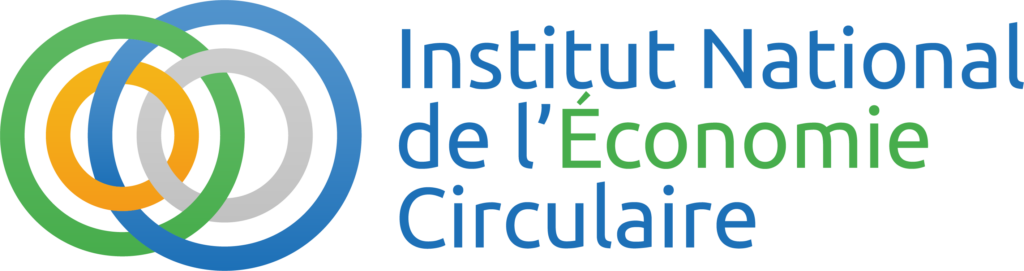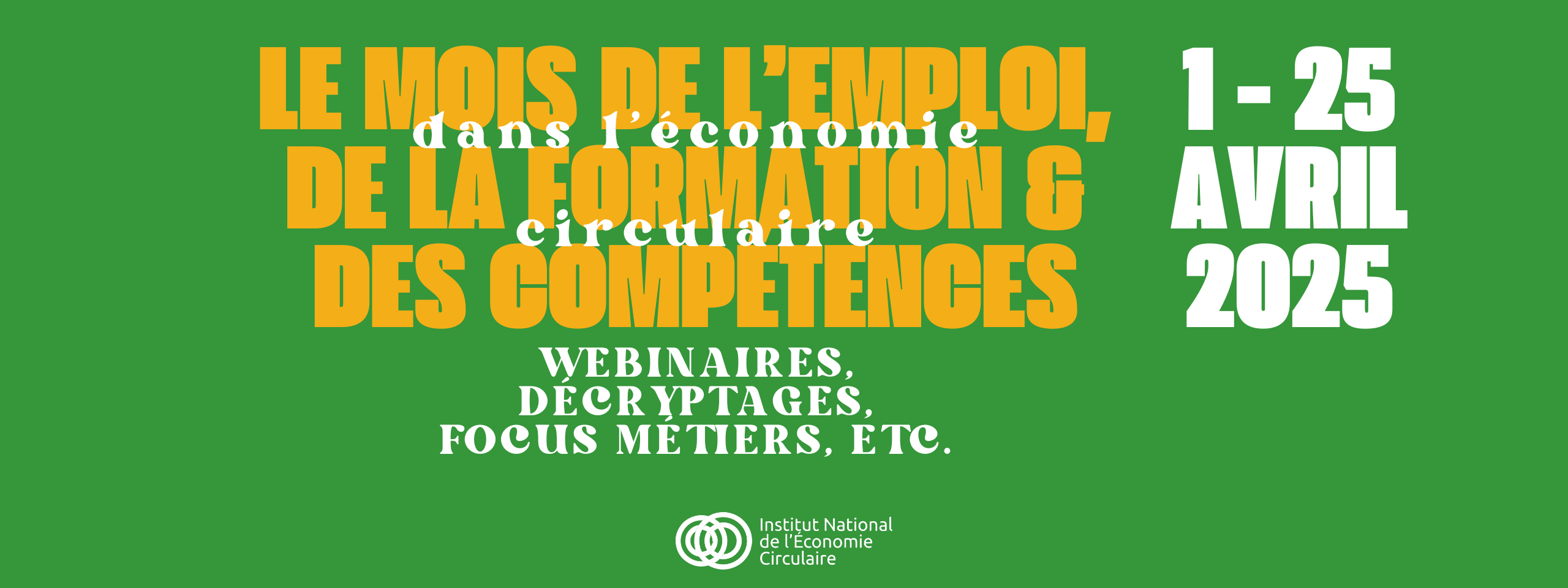VEILLE RÉGLEMENTAIRE
EUROPE
Publication sur le renforcement de la diplomatie climatique de l’UE pour l’extension mondiale de la tarification du carbone.
La Commission européenne a publié le 16 octobre une communication qui marque le premier bilan du groupe de travail sur la tarification et la diplomatie internationale du carbone ; visant à promouvoir des politiques de tarification carbone dans plus de 40 pays partenaires.
Cette initiative s’inscrit dans le renforcement de la diplomatie climatique de l’UE et prépare la convergence mondiale vers des marchés du carbone alignés sur le système d’échange de quotas d’émission européen (SEQE-UE).
Evolution des règles européennes sur les instruments de mesure pour accompagner la transition énergétique.
Un rapport du Parlement européen concerne la révision de la directive 2014/32/UE sur les instruments de mesure. Il vise à adapter la législation européenne aux évolutions technologiques récentes en intégrant de nouveaux dispositifs comme les bornes de recharge pour véhicules électriques, les compteurs intelligents ou encore les distributeurs de gaz comprimé.
La directive entend renforcer la transparence, la sécurité et la traçabilité des données issues de ces instruments. Elle met également l’accent sur la neutralité technologique, l’interopérabilité entre systèmes, et la possibilité de transmission des données à distance, tout en garantissant leur intégrité.
Le rapport souligne la contribution de ces instruments à la décarbonation, notamment à travers une meilleure gestion de l’énergie, le suivi de la consommation et l’intégration de vecteurs comme l’hydrogène.
Rapport du Parlement européen sur un nouveau cadre législatif pour les produits adapté à la transition numérique et durable.
Ce rapport propose de réviser le New Legislative Framework (NLF), le cadre européen qui fixe les règles communes pour la mise sur le marché des produits, afin de mieux intégrer les enjeux environnementaux et numériques. Il insiste sur l’introduction d’un Digital Product Passport (DPP), un passeport numérique des produits, qui regroupera des informations sur leur durabilité, réparabilité, recyclabilité et traçabilité, et s’appliquera à tous les produits, y compris d’occasion.
Ce dispositif permettra d’améliorer la traçabilité et la circularité des biens tout en soutenant les modèles de réemploi et d’économie circulaire.
La Commission européenne appelle à l’adoption d’un cadre mondial ambitieux pour la décarbonation du transport maritime lors du Comité de protection du milieu marin (MEPC).
L’Union européenne soutient l’adoption par l’OMI d’un cadre mondial “zéro émission nette” pour la décarbonation du transport maritime, prévue en octobre 2025.
Après cette adoption, la Commission européenne prévoit de réviser les réglementations existantes notamment le système EU ETS et le règlement FuelEU Maritime afin d’assurer leur cohérence avec le nouveau cadre international.
INSTITUTIONS
Le Cerema présente une étude sur l’économie circulaire dans le secteur du BTP et la nouvelle vie des matériaux.
Le Cerema présente un état des lieux et des retours d’expériences sur l’économie circulaire dans le secteur du BTP, particulièrement dans la gestion des matériaux et des déchets de chantier.
Il met en lumière les bénéfices économiques, environnementaux et techniques liés à la réutilisation, au recyclage, à la valorisation locale des matériaux et aux innovations dans les processus de construction.
Il propose également des recommandations pour les collectivités et maîtres d’ouvrage : impliquer tôt les filières de réemploi, définir des stratégies territoriales de circularité, développer des plateformes de mise en relation pour matériaux de récupération, simplifier les cadres réglementaires et financer les projets pilotes.
Le document insiste sur l’importance de la traçabilité des matériaux et des mesures incitatives pour encourager le recours à des matériaux circulaires dans les marchés publics du BTP.
BUDGET
Le gouvernement présente un projet de loi de finances (PLF) 2026 marqué par des ajustements dans les financements écologiques .
S’agissant des déchets, le PLF prolonge la trajectoire de hausse de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) jusqu’en 2030. La taxe sur les déchets enfouis passerait de 65 €/t à 105 €/t d’ici 2030 (soit environ +10 % par an). La taxe sur les déchets incinérés augmenterait également, atteignant 20 €/t pour les installations performantes et 45 €/t pour les moins performantes. Le taux de TVA pour la gestion des déchets serait harmonisé à 5,5 % pour toutes les prestations achetées par les collectivités.
S’agissant des plastiques, le gouvernement souhaite faire contribuer les éco-organismes à la taxe plastiques versée à l’UE, à hauteur de 30 €/t de plastique non recyclé en 2026, avec une montée progressive à 150 €/t en 2030. Un doublement du tarif est envisagé pour les bouteilles en plastique.
Quant au financement de l’eau, le plafond des recettes des agences de l’eau serait relevé de 50 M€, pour atteindre 2,398 Md€, un niveau inférieur aux engagements annoncés dans le cadre du plan eau. La redevance pour pollutions diffuses reste inchangée. Le plafond de la taxe sur les engins maritimes est relevé de 2,5 M€, au bénéfice du Conservatoire du littoral.
DÉCHETS
Un débat public s’ouvre pour construire le futur plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs (PNGMDR) 2027-2031.
L’État français ouvre une consultation publique pour élaborer la sixième édition du PNGMDR couvrant la période 2027‑2031. Le dossier de maîtrise d’ouvrage est publié, et la Commission nationale du débat public (CNDP) organise des échanges jusqu’au 10 février 2026 pour recueillir les avis des citoyens et parties prenantes.
Ce plan national vise à actualiser le cadre de gestion des matières et déchets radioactifs : bilan des filières existantes, anticipation des besoins de stockage, traitement des déchets non encore pris en charge, valorisation potentielle, et adaptation du plan “Cigéo”.
Les grands enjeux portent sur la planification résiliente, la transparence, la gestion des déchets faiblement radioactifs à vie longue et l’articulation avec les projets futurs du nucléaire en France.
RÉPARATION
Les Journées Nationales de la Réparation (JNR) invitent à réparer pour réduire les déchets.
Les Journées Nationales de la Réparation organisées du 16 au 19 octobre 2025, visent à sensibiliser les citoyens à l’importance de la réparation pour allonger la durée de vie des objets, réduire les déchets et limiter l’empreinte environnementale de la consommation.
Portées par un collectif d’acteurs (associations, réparateurs, collectivités, entreprises), ces journées proposent partout en France des ateliers pratiques, conférences, démonstrations de savoir-faire, ainsi que des temps d’échange avec les professionnels du secteur.
L’édition 2025 valorise les métiers de la réparation encore méconnus et en tension, et promeut les dispositifs de soutien publics comme le bonus réparation, qui a permis de réparer plus de 900 000 produits en un an.
L’initiative veut aussi faire évoluer les comportements d’achat et encourager les consommateurs à privilégier des produits durables et réparables, soutenus par des outils comme l’indice de réparabilité et le futur indice de durabilité.
URBANISME
Le texte de la proposition de loi sur la simplification du droit de l’urbanisme et du logement a été adopté par l’Assemblée nationale.
Cette proposition de loi vise à simplifier et accélérer les procédures d’urbanisme et de construction, dans un contexte de crise du logement. Elle comprend des mesures pour alléger les démarches administratives, réduire les délais d’instruction des permis de construire, faciliter les opérations de densification urbaine et sécuriser juridiquement les documents d’urbanisme. L’objectif est de relancer la construction de logements en adaptant le droit aux besoins des territoires.
Concernant la transition énergétique, le texte introduit plusieurs mesures pour favoriser le développement des énergies renouvelables : il facilite l’intégration dans les documents d’urbanisme de projets liés à la production d’énergie solaire, à l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, ou encore aux installations de stockage d’électricité. Ces ajustements permettent une meilleure compatibilité entre la planification urbaine et les objectifs de neutralité carbone.